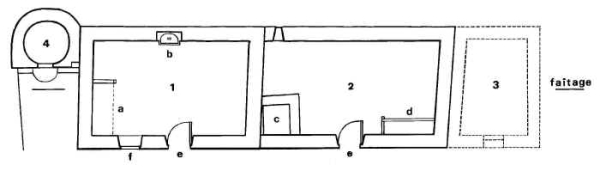|
LA MAISON LONGUE OU
"LONGÈRE"
C'était la
maison des petits paysans (journaliers possédant un petit lopin,
métayers, petits exploitants) et des petits artisans. Elle était
très répandue dans les zones de pauvreté, en particulier dans tout
l'Ouest. C'est une maison étroite, à développement en longueur
selon l'axe de la faîtière, de plain-pied, aux accès généralement en
gouttereau, plus rarement en pignon.
Dans les "longères" purement
paysannes, on distingue, selon l'articulation des locaux d'exploitation à
la pièce d'habitation, quatre types :
- la "longère" à pièce unique
commune aux hommes et aux animaux,
- la "longère" à pièce d'habitation
augmentée d'une étable,
- la "longère" à pièce d'habitation augmentée
d'une grange-étable,
- la "longère" à étable ou à grange-étable
dissociée, formant l'amorce d'une cour ouverte.
Dans les "longères" à
cohabitation des humains et du cheptel (attestées en basse Bretagne,
Normandie, Mayenne, Anjou, mais aussi dans le Cantal, la Lozère et les
Pyrénées ariégeoises), le bétail était relégué à l'extrémité opposée au
foyer, le sol étant en pente pour éviter que le purin n'envahisse la
pièce. Dans le meilleur des cas, une cloison en planches séparait l'étable
de la pièce d'habitation.
Les aménagements étaient des plus sommaires :
une cheminée adossée au pignon avec un four extérieur, un évier ménagé en
gouttereau à côté de la porte d'entrée. Le mobilier comportait une table
(succédant au plateau sur tréteaux commun avant le 17e siècle), des lits
plus ou moins clos, un pétrin, un bahut (remplaçant le coffre où l'on
rangeait vêtements et objets précieux), un vaisselier, une armoire, des
bancs ou des chaises (ces dernières se généralisant après 1850).
|